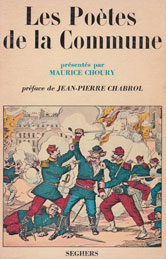Le coin de table par Fantin Latour 1872 (détail)
« Je suis celui qui souffre et qui s’est révolté ! »
Extraits de l’article de Maurice Choury paru dans les Poètes de la Commune, Editions Seghers, 1970
On a dit de Rimbaud que c’était un révolté et qu’il fallait situer l’origine de sa révolte dans l’extrême sévérité de sa terrible mère. De fait, la plupart des témoignages concordent pour reconnaître la stupide bigoterie, l’avarice, les opinions réactionnaires et le caractère despotique de Marie-Catherine-Félicité Cuif, la vertueuse épouse du capitaine Frédéric Rimbaud.(…)
Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud, le cadet, né le 20 octobre 1854 à Charleville, souffre dès la prime enfance de la rigide dictature qui règne dans la prison familiale.
Ses premières narrations, ses premiers poèmes trahissent l’être frustré d’amour maternel. Dans un texte rédigé à l’âge de dix ans, il évoque le rêve qu’il a fait d’une mère « douce, calme, s’effrayant de peu de chose » ; mais la réalité ce sont les soufflets « accordés pour récompense » et les propos vexants.(…)
Le seul argent de poche que connaisse son fils, ce sont les dix centimes qu’elle lui donne le dimanche pour payer son prie-Dieu, à l’église. (…)
Dans une lettre du 28 août 1871 adressée à son ami le poète Paul Demeny, Rimbaud situera parfaitement sa position de « prévenu » face à une « mère aussi inflexible que soixante-treize administrations à casquettes de plomb », à ses « apostrophes grossières et méchantes » et à ses « atroces résolutions ». Un travail inepte et perpétuel à Charleville, ou la porte, voilà le dilemme que lui offre son tortionnaire, « voilà, écrit-il, le mouchoir de dégoût qu’on m’a enfoncé dans la bouche… »
« Je suis celui qui souffre et qui s’est révolté! » s’exclame Rimbaud, à la même époque .
Mais son cri dépasse la révolte ; son cri est un appel à la Révolution.
Rimbaud en juin 72 par Verlaine
<–
Rimbaud en 1871
par Delahaye
–>
Dès l’âge de treize ans il manifeste sans ambiguïté ses opinions révolutionnaires (…) Le pauvre abbé auquel est dévolu l’enseignement de l’histoire au collège de Charleville est saisi d’épouvante quand il découvre, dans les devoirs du jeune rhètoricien des invocations ardentes aux géants de la Révolution, N’y a-t-il point là une atteinte à la sûreté de l’État?… Ce qui sauve alors le jeune révolutionnaire des foudres de la répression impériale c’est qu’il vient de remporter le concours de vers latins de l’Académie de Douai.
Après avoir dévoré l’œuvre du baron d’Holbach, d’Helvétius, de Jean-Jacques, il étudie Babeuf, Louis Blanc, puis Proudhon. A-t-il connaissance des écrits de Blanqui ? On serait tenté de le croire, à le voir préconiser Une nouvelle révolution. Il estime qu’ « il est des destructions nécessaires » de même qu’il y a de vieux arbres bons à couper.
« On rasera les fortunes et l’on abattra les orgueils individuels. Un homme ne pourra plus dire : « Je suis plus puissant, plus riche. » On remplacera l’envie amère et l’admiration stupide par la paisible concorde, l’égalité, le travail de tous pour tous… »
Le communisme ?
Oui, le communisme! (…)
Révolte contre l’ordre social établi, mais aussi révolte du matérialiste —Il se classe comme tel — contre la Religion et contre l’Église.
Les poètes de la Commune par Maurice Choury Ed Seghers 1970 réédité en 2021
Le non-conformiste qui écrira Merde à Dieu sur les bancs des promenades publiques et sur les murs des églises de Charleville ne peut pas approuver la guerre dynastique que Napoléon III entreprend en juillet 1870 pour affermir son trône : il accueille avec mépris le courant d’hystérie chauvine soulevé par la déclaration de guerre et refuse fermement de signer une lettre dans laquelle ses condisciples offrent au ministre de l’Instruction publique de faire le sacrifice de leurs livres de prix au bénéfice de la défense nationale.
Dans la lettre qu’il écrit le 25 août 1870 à son ancien professeur de rhétorique Georges Izambard, alors à Douai, il décrit sa ville natale devenue « supérieurement idiote » : « Parce qu’elle voit pérégriner dans ses rues deux ou trois cents pioupious, cette benoîte population gesticule, prudhommes-quement spadassine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg ! C’est effrayant les épiciers retraités qui revêtent l’uniforme ! C’est épatant comme ça a du chien les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chassepot au cœur, font du patrouillotisme aux portes de Mézières ; ma patrie se lève !… Moi, j’aime mieux la voir assise ; ne remuez pas les bottes ! c’est mon principe. »
Quatre jours plus tard, après avoir vendu ses livres de prix du concours académique il quitte « l’atroce Charlestown » et ses « Caropolmerdeux », ses « bourgeois poussifs » et leurs « bêtises jalouses », ses « rentiers à lorgnons », ses « épiciers retraités qui — dans le square de la gare — tisonnent le sable avec leur canne à pomme », et prend le train pour Charleroi où, avec ses derniers sous il achète un billet de chemin de fer pour Saint-Quentin. Mais il poursuit jusqu’à Paris. A la gare du Nord, dans l’impossibilité de payer les treize francs de surtaxe pour le supplément de trajet effectué, le resquilleur est arrêté, conduit au dépôt puis à la prison de Mazas.(…)
Le lendemain, l’Empire est renversé et la République proclamée. Le captif appelle aussitôt à son secours le cher Izambard, lequel le tire d’affaire, lui envoie le prix du voyage et l’héberge chez lui, à Douai. C’est là qu’il ciselle cette merveille de sensibilité et de rythme, Les Effarés :
«Nus dans la neige et dans la brume, …»
A Douai, le remuant gamin ne tarde pas à s’intéresser à la politique locale. Le 20 septembre 1870, au nom des membres de la légion de la Garde nationale sédentaire de Douai, il rédige une lettre de protestation, rendue publique, contre une déclaration du Maire tendant à innocenter le gouvernement déchu de l’insuffisance d’armement dont se plaint la milice citoyenne. (…)
Rimbaud demeurerait volontiers à Douai, où il s’est fait un nouvel ami, le poète Paul Demeny, mais la « mère Rimb » intime au « petit drôle » l’ordre de rentrer à Charleville et fulmine contre Izambard, qui est sommé de le chasser …
La vigueur de l’accueil n’incite guère Rimbaud à la sédentarité. La route l’appelle, la route à laquelle il consacra cette poignante fantaisie, Ma bohème :
« Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées (…)
Dix jours après son retour il s’enfuit à toutes jambes en direction de la Belgique :
« … J’avais déchiré mes bottines
« Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi… »
Il espère s’y faire embaucher dans le journal que dirige le père d’un de ses anciens condisciples (…) L’hôte fait vite comprendre au « jeune homme » qu’il n’y a pas de place pour lui dans un journal « qui se respecte et qui a des traditions… »
Sans feu ni lieu, notre petit chemineau soupe « en humant l’odeur des soupiraux d’où s’exhalaient les fumets des viandes et des volailles rôties des bonnes cuisines bourgeoises de Charleroi » et, le ventre creux, prend la route de Bruxelles. Dans la capitale belge, un providentiel ami d’Izambard le requinque et le renippe et c’est presque un gandin qui, par le train, regagne Douai. Cette fois Izambard est bien ennuyé : il ne peut pas le garder, sous peine d’encourir la vindicte de l’irascible « Mother ». Il ne veut pas non plus le chasser… Il doit se résoudre à demander ses instructions à la mère du mineur. Qu’il charge la police du rapatriement, sans frais bien entendu : telle est la réponse de M » » Rimbaud.
Et voilà le malheureux enfant de nouveau prisonnier à Charleville. Il voudrait repartir mais il ne le fait pas, car il a promis à Izambard de rester sage. Il sombre dans la neurasthénie :
« Je me meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille, écrit-il à son ami. Que voulez-vous ? Je m’entête affreusement à adorer la liberté libre… »
Mézières et Charleville ne sont pas encore investies ; Rimbaud n’a donc été frappé par aucune image de la guerre, mais sa puissante imagination donne naissance à ce pur chef-d’œuvre : Le dormeur du val (…) Malgré la rudesse de l’hiver, Rimbaud reprend ses courses dans la campagne désolée qui attend, anxieuse, l’arrivée des Prussiens. Cet hiver 70-71 est celui d’une belle fécondité pour le poète.
La capitulation de Paris ne l’affecte guère : enfin le blocus de la capitale est levé ! Le printemps est en vue, le « piéton de la grand-route » se sent des fourmis dans les jambes. Il vend sa montre et, le 25 février 1871, prend le train en compagnie d’une demoiselle qui le tient sous le charme du « rayon violet de ses yeux ». Ils passent leur première nuit parisienne sur un banc des boulevards. A l’aube, il la conduit à la gare du Nord et lui remet ses derniers sous pour qu’elle puisse rejoindre de vagues parents, en grande banlieue. Lui, part vers sa destinée de poète calamiteux.
Errant dans la grand’ville à la recherche d’un gîte et d’un moyen d’existence. (…) Commence pour lui une existence de clochard famélique. Il se nourrit d’épluchures, couche dans des péniches ou sous les ponts, déambule par les rues, aussi avide de nourriture spirituelle que d’aliments. Sur ce séjour parisien nous sommes très exactement renseignés par une lettre de Rimbaud lui-même, adressée à son ami Paul Demeny. D’abord sur la durée du séjour : deux semaines à peine ! du 25 février au 10 mars 1871. Mais ce sont là des semaines décisives pour la maturation d’événements qui vont aboutir à l’explosion du 18 mars et à l’instauration de la Commune. (…) Au cours de son séjour à Paris, par ce qu’il voit dans la rue, par la lecture des journaux il s’enrichit d’impressions qui renforcent ses convictions révolutionnaires et qui lui fourniront la matière de ses poèmes « communards »…(…)
Mais la carcasse a elle aussi ses exigences et le poète meurt littéralement de faim. La mort dans l’âme, il reprend le 10 mars, à pied, la route de Charleville, cruelle épreuve dont nous retrouvons la trace dans Une saison en enfer :
« Sur les routes, par des nuits d’hiver, sans gîte, sans habits, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé : « Faiblesse ou force : te voilà, c’est la force. Tu ne sais ni où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tueras pas plus que si tu étais cadavre. Au matin j’avais le regard si perdu et la contenance si morte, que ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu. »
Il arrive à Charleville en loques et à demi mort de fatigue et de misère, sous les aboiements furieux du « crocodile ».
Dès lors, il défie avec ostentation la bourgeoisie de sa ville natale. Il déambule, cheveux dans le cou, pipe au fourneau retourné vers le sol, tenant des propos jugés provocateurs par les petits vieux bien propres qui ont voté oui aux plébiscites impériaux. « Ça y est… L’Ordre est vaincu ! » clame-t-il à tous vents, à l’annonce de l’insurrection parisienne et il catéchise les casseurs de cailloux en faveur des Communards.
En juin ou juillet 1871, alors que la répression accable les vaincus, Rimbaud chante dans Les mains de Jeanne-Marie les femmes combattantes de la Commune, les fières mécréantes qui braquaient hier les mitrailleuses et qui sont maintenant enchaînées. (…) Il ne connaîtra plus l’exaltation du combat sous les drapeaux rouges frissonnants. Il n’aura plus le cœur de nager dans une où se balancent les pontons qui servent de prisons aux fédérés battus… (…)
Rimbaud a vécu par l’imagination toute la passion des fédérés dans « la ville énorme au ciel taché de feu et de boue » : « J’aurais pu y mourir. »
«… Je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel : et à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres. »
Après une succession de séjours à Bruxelles et à Londres, entrecoupés de retours à Charleville, Rimbaud rentre à Roche où il termine Une saison en enfer (août 1873).
Il a dit tout ce qu’il avait à dire. Il a dit son amour des ouvriers. Il a souhaité que « des mouvements de fraternité sociale soient chéris. »
Il a dit la nécessité de briser « l’infini servage de la femme »! sa « sœur de charité ». Il a chanté l’hymne à « la science, la nouvelle noblesse »
Tout est dit. Le poète se tait définitivement. Il n’a pas encore dix-neuf ans… Il lui reste encore à vivre un calvaire de dix-huit années. (…) Cherchant en vain jusqu’au fond de l’Abyssinie le repos, la sécurité et un fils pour « faire le dernier couac! » le 10 novembre 1891, à l’âge de trente-sept ans, emporté par la gangrène, sur un grabat d’hôpital marseillais, trahi par sa propre sœur qui, à la faveur de son coma, lui fabrique une fin chrétienne…
Et pour terminer, un magnifique poème de René Char issu du recueil Fureur et mystère édité en 1948
Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud !
Tes dix-huit ans réfractaires à l’amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris ainsi qu’au ronronnement d’abeille stérile de ta famille ardennaise un peu folle, tu as bien fait de les éparpiller aux vents du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d’abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisse-lyres, pour l’enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples.
Cet élan absurde du corps et de l’âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c’est bien là la vie d’un homme ! On ne peut pas, au sortir de l’enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies.
Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ! Nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi.