Pour terminer cette série de textes de l’auteur allemand Patrick Süskind, je vous propose des extraits du début de son fameux roman « Le parfum – Histoire d’un meurtrier ».
Lors de sa publication, en 1985, Bernard Pivot avait souligné que « il sent à chaque page ». Partagerez-vous mon admiration pour les descriptions minutieuses des personnages, des lieux et des odeurs tout au long de cet étrange roman ?
Patrick Süskind
Patrick Süskind est surtout connu pour son premier roman « Le Parfum », écrit à l’âge de 36 ans, en 1985. L’ouvrage a été traduit en 48 langues et vendu à 20 millions d’exemplaires.
Sa pièce de théâtre « La Contrebasse » précède de 4 ans ce premier roman.
Patrick Süskind a finalement assez peu publié (principalement « Le Pigeon ») et a aussi travaillé comme scénariste, en particulier pour des adaptations de ses œuvres au cinéma.
Patrick Süskind excelle dans la description minutieuse des lieux (Paris au XVIII° siècle dans « Le Parfum »), des événements, et des états d’âmes des personnages, apparemment ordinaires et dont la fragilité (« La Contrebasse »), voire la folie pure et simple (« Le Parfum », « Le Pigeon »), apparaît peu à peu.
Benoit
Le Parfum (extraits)
De sa naissance à sa condamnation, la vie mouvementée de Jean-Baptiste Grenouille est conditionnée par les odeurs que l’auteur nous décrit aussi fidèlement que le Paris du XVIII° siècle.
« Le Parfum », un livre qui sent à chaque page…
Patrick Süskind : « Le Parfum », Editions Diogenes Verlag AG – 1985 (et aussi Fayard, Le livre de Poche)
Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C’est son histoire qu’il s’agit de raconter ici. Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux d’autres scélérats de génie comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, moins ennemi de l’humanité, moins immoral, en un mot moins impie que ces malfaisants plus illustres, mais c’est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l’histoire : au royaume évanescent des odeurs.
A l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton ; les pièces d’habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leurs bains corrosifs, et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés ; leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d’oignons, et leurs corps, dès qu’ils n’étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l’épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite, aussi n’y avait-il aucune activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur. […]
C’est là, à l’endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C’était l’une des journées les plus chaudes de l’année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans les ruelles avoisinantes son haleine pestilentielle, où se mêlaient l’odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue aux Fers et écaillait des gardons qu’elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l’odeur de cadavre. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs, et du reste elle avait mal dans tout le milieu du corps, et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n’avait qu’une envie, c’était que cette douleur cessât, elle voulait s’acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C’était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal et, à tous les coups, ç’avait été un enfant mort-né ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poisson qui gisaient sur le sol, et ne vivait d’ailleurs guère davantage, et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve. C’est ce qui allait se passer une fois de plus, et la mère de Grenouille, qui était encore une jeune femme, vingt-cinq ans tout juste, qui était encore tout à fait jolie et qui avait encore presque toutes ses dents et encore des cheveux sur la tête, et qui à part la goutte, la syphilis et un peu de phtisie n’avait aucune maladie grave, qui espérait vivre encore longtemps, peut-être cinq ou dix ans, et peut-être même se marier un jour et avoir de vrais enfants en étant la respectable épouse d’un artisan qui aurait perdu sa femme, par exemple…, la mère de Grenouille souhaitait que tout cela finisse. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s’accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d’arriver là. […]
Jean-Baptiste Grenouille survit miraculeusement ; il est mis en nourrice par le moine Terrier. La dernière nourrice vient lui rapporter l’enfant.
— Il est possédé par le diable.
Terrier retira vite ses doigts du panier.
— Impossible ! C’est absolument impossible qu’un nourrisson soit possédé par le diable. Un nourrisson n’est pas un être humain, cela n’en est que l’ébauche et son âme n’est pas encore formée. Par conséquent il ne présente pas d’intérêt pour le diable. Est-ce que par hasard il parle déjà ? Est-ce qu’il a des mouvements convulsifs ? Est-ce qu’il fait déplacer des objets dans sa chambre ? Est-ce qu’il exhale une mauvaise odeur ?
— Il ne sent absolument rien, dit la nourrice.
— Tiens, tu vois ! C’est un signe qui ne trompe pas. S’il était possédé par le diable, il ne pourrait pas ne pas puer.
Et afin de rassurer la nourrice et de faire la preuve de son propre courage, Terrier souleva le panier et le porta à son nez.
— Je ne sens rien de bizarre, dit-il après avoir reniflé quelques instants, vraiment rien de bizarre. Il me semble tout de même qu’il y a là dans ses couches quelque chose qui sent.
Et il tendit le panier à la femme, pour avoir confirmation.
— Je ne vous parle pas de ça, dit sèchement la nourrice, en repoussant le panier. Je ne vous parle pas de ce qu’il y a dans les couches. Bien sûr que ses excréments sentent. Mais lui-même, ce bâtard, il n’a pas d’odeur.
— C’est parce qu’il est en bonne santé, s’écria Terrier. Il se porte bien, alors il n’a pas d’odeur. Il n’y a que les enfants malades qui ont une odeur, c’est bien connu. Tout le monde sait qu’un enfant qui a la petite vérole sent le crottin de cheval ; s’il a la scarlatine, il sentira les pommes blettes, et s’il souffre de consomption, il sentira les oignons. Celui-ci est en bonne santé, c’est tout ce qu’il a. Tu voudrais qu’il pue ? Est-ce qu’ils puent, tes propres enfants ?
— Non, dit la nourrice, mes enfants ont l’odeur que doivent avoir des enfants d’homme. […]
— Aurais-tu l’obligeance de me dire quelle odeur a donc un nourrisson quand il a l’odeur que tu crois qu’il doit avoir ? Hein ?
— Une bonne odeur, dit la nourrice.
— « Bonne », ça veut dire quoi ? cria Terrier à la figure de la femme. Il y a bien des choses qui sentent bon. Un bouquet de lavande sent bon. Le pot-au-feu sent bon. Les jardins de l’Arabie sentent bon. Comment sent un nourrisson, je voudrais bien le savoir !
La nourrice hésitait. Elle savait bien quelle odeur avaient les nourrissons, elle le savait parfaitement bien, ce n’est pas pour rien que par douzaines elle en avait nourri, soigné, bercé, embrassé… Elle était capable, la nuit, de les trouver rien qu’à l’odeur et, à l’instant même, elle avait très précisément cette odeur de nourrisson dans le nez. Mais jamais encore elle ne l’avait désignée par des mots.
— Eh bien ? aboyait Terrier en faisant claquer le bout de ses ongles.
— C’est que, n’est-ce pas, commença la nourrice, ce n’est pas très facile à dire, parce que… ils ne sentent pas partout pareil, quoiqu’ils sentent bon partout, mon Père, vous comprenez… Prenez leurs pieds, par exemple, eh bien là ils sentent comme un caillou lisse et chaud ; ou bien non, plutôt comme du fromage blanc… ou comme du beurre, comme du beurre frais, oui, c’est ça : ils sentent le beurre frais. Et le reste du corps sent comme… comme une galette qu’on a laissé tremper dans le lait. Et la tête, là, l’arrière de la tête, où les cheveux font un rond, là, regardez, mon Père, là où vous n’avez plus rien…
Et comme Terrier, médusé par ce flot de sottises minutieusement détaillées, avait docilement incliné la tête, elle tapotait sa calvitie.
— … c’est là, très précisément qu’ils sentent le plus bon. Là, ils sentent le caramel, cela sent si bon, c’est une odeur si merveilleuse, mon Père, vous n’avez pas idée ! Quand on les a sentis à cet endroit-là, on les aime, que ce soient les siens ou les enfants des autres. Et c’est comme ça, et pas autrement, que doivent sentir les petits enfants. Et quand ils ne sentent pas comme ça, quand là-haut derrière la tête ils ne sentent rien du tout, encore moins que de l’air froid, comme celui-là, ce bâtard, alors… Vous pouvez expliquer ça comme vous voulez, mon Père, mais moi…
Comment cet innocent nourrisson qui ne sent rien deviendra-t-il un génie du parfum doublé d’un meurtrier ?
Pour tout savoir, il vous reste à lire ou relire « Le Parfum »…
Benoit



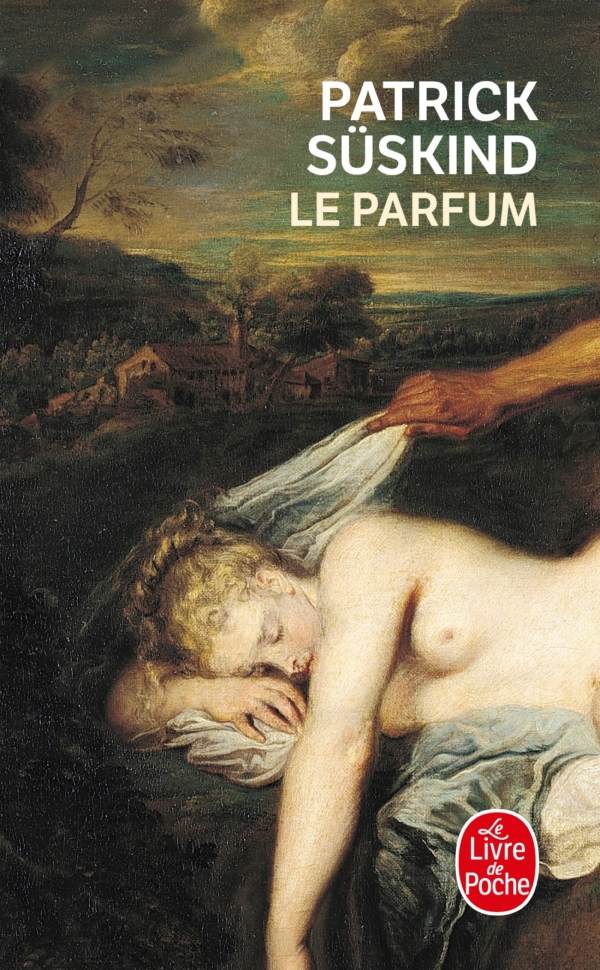




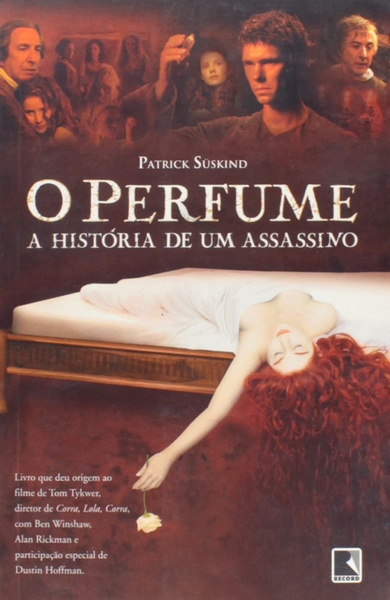


Mais bien sûr à relire, livre fascination/répulsion! Mais enfin même pas une petite lecture à voix haute pour m’inviter à le dénicher dans ma bibliothèque toujours , surtout pas en mode classée, je suis déclassée dans cet ordre-là !
oh, là, là, je suis tristounette, mais sans rancune, à bientôt et toujours merci!
nelly
Un livre que j’avais adoré, à relire.