Tout au long de ce mois d’avril 2021, je vous propose des textes de Patrick Süskind, cet allemand auteur de romans et de nouvelles qui ont emballé mon imaginaire de jeune adulte. Partagerez-vous ma sidération à la lecture de ce ‘récit’ peu ordinaire ?
Patrick Süskind
Patrick Süskind est surtout connu pour son premier roman « Le Parfum », écrit à l’âge de 36 ans, en 1985. Mais sa pièce de théâtre « La Contrebasse » précède de 4 ans ce premier roman à succès.
Il a finalement assez peu publié (principalement « Le Pigeon ») et a aussi travaillé comme scénariste, en particulier pour des adaptations de ses œuvres au cinéma.
Patrick Süskind excelle dans la description minutieuse des lieux (Paris au XVII° siècle dans « Le Parfum »), des événements, et des états d’âmes des personnages, apparemment ordinaires et dont la fragilité (« La Contrebasse »), voire la folie pure et simple (« Le Parfum », « Le Pigeon »), apparaît peu à peu.
Benoit
Le Pigeon (extraits)
Ce roman, présenté comme un ‘récit’, nous plonge avec force détails dans l’univers étriqué d’un homme somme toute ordinaire. Sa fragilité vire au tragique lors d’une rencontre fortuite avec un simple pigeon.
Patrick Süskind : « Le Pigeon », Editions Diogenes Verlag AG – 1987 (et Le livre de Poche)
Lorsque lui arriva cette histoire de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine, il avait derrière lui une période d’une bonne vingtaine d’années qui n’avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il n’aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait. Car il n’aimait pas les événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l’ordonnance de sa vie. […]
Il eut par deux fois, beaucoup de chance. Il trouva du travail comme vigile d’une banque de la rue de Sèvres, et il trouva un logement, une chambre de bonne, au sixième étage d’un immeuble de la rue de la Planche. On y accédait en passant par l’arrière- cour, par le petit escalier de service et par un étroit couloir prenant maigrement le jour par une seule fenêtre. Sur ce couloir donnaient deux douzaines de petites chambres aux portes numérotées et peintes en gris, et tout au fond se trouvait le numéro 24, la chambre de Jonathan. Elle mesurait trois mètres quarante de long, deux mètres vingt de large et deux mètres cinquante de haut, et offrait pour tout confort un lit, une table, une chaise, une ampoule électrique et un portemanteau, rien d’autre. […]
Ce n’était pas le confort qu’il recherchait, mais une demeure sûre, qui lui appartînt à lui et à lui seul, qui le mît à l’abri des surprises désagréables de la vie, et d’où personne ne pourrait plus le chasser.[…]
Au cours des années, le numéro 24 de Jonathan était devenu un logis relativement confortable. Il avait acheté un lit neuf, installé un placard, recouvert de moquette grise ses sept mètres carrés et demi de sol, et habillé son coin-toilette-et-cuisine d’un beau papier plastifié de couleur rouge. Il possédait une radio, un appareil de télévision et un fer à repasser. Ses provisions n’étaient plus accrochées comme auparavant dans un sac, à l’extérieur de la fenêtre, il les conservait dans un minuscule frigo placé sous le lavabo, si bien que, même au plus fort de l’été, il n’avait plus son beurre qui coulait ou son jambon qui séchait. A la tête de son lit, il avait installé une étagère, où il n’y avait pas moins de dix-sept livre […].
Du fait de ces nombreuses acquisitions, il est vrai que la chambre était devenue encore plus petite, elle s’était quasiment développée vers l’intérieur comme un coquillage qui aurait sécrété trop de nacre, et avec tous ses aménagements divers et raffinés elle ressemblait plutôt à une cabine de bateau, ou à un compartiment luxueux de wagon-lits, qu’à une modeste chambre de bonne. Mais elle avait conservé, trente années durant, sa qualité essentielle : elle était et demeurait pour Jonathan, dans un monde peu sûr, un îlot de sécurité, elle restait son ancrage et son refuge, sa maîtresse, oui, sa maîtresse, car elle l’accueillait tendrement en elle, sa petite chambre, lorsqu’il rentrait le soir, elle le réchauffait et le protégeait, elle nourrissait son corps et son âme, elle était toujours là quand il avait besoin d’elle, et elle ne l’abandonnait jamais. Elle était de fait la seule chose qui, dans sa vie, se fût avérée digne de confiance. Et c’est pourquoi il n’avait jamais songé un instant à se séparer d’elle, même maintenant qu’il avait plus de cinquante ans et qu’à l’occasion il éprouvait quelque peine à gravir jusqu’à elle tous ces escaliers, et que ses appointements lui auraient permis de louer un véritable appartement et d’avoir sa cuisine, ses w.-c. et sa salle de bain. Il restait fidèle à sa maîtresse, il était même sur le point de resserrer encore les liens qui les unissaient l’un à l’autre. Il entendait rendre leur liaison à tout jamais indissoluble, il voulait en effet l’acheter.[…]
Voilà où en étaient les choses lorsqu’en août 1984, un vendredi matin, se produisit l’histoire du pigeon.[…]
De la main gauche il tourna le bouton du verrou de sécurité, de la droite la poignée de la serrure, le pène rentra, Jonathan tira d’une secousse légère, et la porte s’entrebâilla, puis s’ouvrit. Pour un peu, il avait déjà enjambé le seuil, son pied était déjà en l’air, le gauche, sa jambe était déjà lancée en avant… quand il le vit. Il était posé devant sa porte, à moins de vingt centimètres du seuil, dans la lueur blafarde du petit matin qui filtrait par la fenêtre. Il avait ses pattes rouges et crochues plantées sur le carrelage sang de bœuf du couloir, et son plumage lisse était d’un gris de plomb : le pigeon. Il avait penché sa tète de côté et fixait Jonathan de son œil gauche. Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre, était effrayant à voir. Il était fixé comme un bouton cousu sur le plumage de la tête, il était dépourvu de cils et de sourcils, il était tout nu et impudemment tourné vers l’extérieur, et monstrueusement ouvert ; mais en même temps il y avait là, dans cet œil, une sorte de sournoiserie retenue ; et, en même temps encore, il ne semblait être ni sournois, ni ouvert, mais tout simplement sans vie, comme l’objectif d’une caméra qui avale toute lumière extérieure et ne laisse passer aucun rayon en provenance de son intérieur. Il n’y avait pas d’éclat, pas de lueur dans cet œil, pas la moindre étincelle de vie. C’était un œil sans regard. Et il fixait Jonathan.[…]
Pendant peut-être cinq, peut être dix secondes — il lui parut à lui que c’était pour toujours —, il resta figé, la main sur la poignée et le pied levé pour faire son premier pas, sans pouvoir avancer ni reculer. Puis il se produisit un petit mouvement. Ou bien le pigeon prit appui sur son autre patte, ou bien il se rengorgea un petit peu, en tout cas une brève secousse parcourut son corps, et en même temps deux paupières se refermèrent d’un coup sec sur son œil, l’une d’en bas et l’autre d’en haut, pas vraiment des paupières, en fait, mais plutôt des sortes de clapets en caoutchouc qui, comme des lèvres surgies de nulle part, avalèrent l’œil. Pour un moment, il avait disparu. Et c’est là seulement que Jonathan sentit la fulguration de la frayeur, là que ses cheveux se hérissèrent d’une horreur panique.
Lorsque lui arriva cette histoire de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine, il avait derrière lui une période d’une bonne vingtaine d’années qui n’avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il n’aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait. Car il n’aimait pas les événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l’ordonnance de sa vie. […]
Il eut par deux fois, beaucoup de chance. Il trouva du travail comme vigile d’une banque de la rue de Sèvres, et il trouva un logement, une chambre de bonne, au sixième étage d’un immeuble de la rue de la Planche. On y accédait en passant par l’arrière- cour, par le petit escalier de service et par un étroit couloir prenant maigrement le jour par une seule fenêtre. Sur ce couloir donnaient deux douzaines de petites chambres aux portes numérotées et peintes en gris, et tout au fond se trouvait le numéro 24, la chambre de Jonathan. Elle mesurait trois mètres quarante de long, deux mètres vingt de large et deux mètres cinquante de haut, et offrait pour tout confort un lit, une table, une chaise, une ampoule électrique et un portemanteau, rien d’autre. […]
Ce n’était pas le confort qu’il recherchait, mais une demeure sûre, qui lui appartînt à lui et à lui seul, qui le mît à l’abri des surprises désagréables de la vie, et d’où personne ne pourrait plus le chasser.[…]
Au cours des années, le numéro 24 de Jonathan était devenu un logis relativement confortable. Il avait acheté un lit neuf, installé un placard, recouvert de moquette grise ses sept mètres carrés et demi de sol, et habillé son coin-toilette-et-cuisine d’un beau papier plastifié de couleur rouge. Il possédait une radio, un appareil de télévision et un fer à repasser. Ses provisions n’étaient plus accrochées comme auparavant dans un sac, à l’extérieur de la fenêtre, il les conservait dans un minuscule frigo placé sous le lavabo, si bien que, même au plus fort de l’été, il n’avait plus son beurre qui coulait ou son jambon qui séchait. A la tête de son lit, il avait installé une étagère, où il n’y avait pas moins de dix-sept livre […].
Du fait de ces nombreuses acquisitions, il est vrai que la chambre était devenue encore plus petite, elle s’était quasiment développée vers l’intérieur comme un coquillage qui aurait sécrété trop de nacre, et avec tous ses aménagements divers et raffinés elle ressemblait plutôt à une cabine de bateau, ou à un compartiment luxueux de wagon-lits, qu’à une modeste chambre de bonne. Mais elle avait conservé, trente années durant, sa qualité essentielle : elle était et demeurait pour Jonathan, dans un monde peu sûr, un îlot de sécurité, elle restait son ancrage et son refuge, sa maîtresse, oui, sa maîtresse, car elle l’accueillait tendrement en elle, sa petite chambre, lorsqu’il rentrait le soir, elle le réchauffait et le protégeait, elle nourrissait son corps et son âme, elle était toujours là quand il avait besoin d’elle, et elle ne l’abandonnait jamais. Elle était de fait la seule chose qui, dans sa vie, se fût avérée digne de confiance. Et c’est pourquoi il n’avait jamais songé un instant à se séparer d’elle, même maintenant qu’il avait plus de cinquante ans et qu’à l’occasion il éprouvait quelque peine à gravir jusqu’à elle tous ces escaliers, et que ses appointements lui auraient permis de louer un véritable appartement et d’avoir sa cuisine, ses w.-c. et sa salle de bain. Il restait fidèle à sa maîtresse, il était même sur le point de resserrer encore les liens qui les unissaient l’un à l’autre. Il entendait rendre leur liaison à tout jamais indissoluble, il voulait en effet l’acheter.[…]
Voilà où en étaient les choses lorsqu’en août 1984, un vendredi matin, se produisit l’histoire du pigeon.[…]
De la main gauche il tourna le bouton du verrou de sécurité, de la droite la poignée de la serrure, le pène rentra, Jonathan tira d’une secousse légère, et la porte s’entrebâilla, puis s’ouvrit. Pour un peu, il avait déjà enjambé le seuil, son pied était déjà en l’air, le gauche, sa jambe était déjà lancée en avant… quand il le vit. Il était posé devant sa porte, à moins de vingt centimètres du seuil, dans la lueur blafarde du petit matin qui filtrait par la fenêtre. Il avait ses pattes rouges et crochues plantées sur le carrelage sang de bœuf du couloir, et son plumage lisse était d’un gris de plomb : le pigeon. Il avait penché sa tète de côté et fixait Jonathan de son œil gauche. Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre, était effrayant à voir. Il était fixé comme un bouton cousu sur le plumage de la tête, il était dépourvu de cils et de sourcils, il était tout nu et impudemment tourné vers l’extérieur, et monstrueusement ouvert ; mais en même temps il y avait là, dans cet œil, une sorte de sournoiserie retenue ; et, en même temps encore, il ne semblait être ni sournois, ni ouvert, mais tout simplement sans vie, comme l’objectif d’une caméra qui avale toute lumière extérieure et ne laisse passer aucun rayon en provenance de son intérieur. Il n’y avait pas d’éclat, pas de lueur dans cet œil, pas la moindre étincelle de vie. C’était un œil sans regard. Et il fixait Jonathan.[…]
Pendant peut-être cinq, peut être dix secondes — il lui parut à lui que c’était pour toujours —, il resta figé, la main sur la poignée et le pied levé pour faire son premier pas, sans pouvoir avancer ni reculer. Puis il se produisit un petit mouvement. Ou bien le pigeon prit appui sur son autre patte, ou bien il se rengorgea un petit peu, en tout cas une brève secousse parcourut son corps, et en même temps deux paupières se refermèrent d’un coup sec sur son œil, l’une d’en bas et l’autre d’en haut, pas vraiment des paupières, en fait, mais plutôt des sortes de clapets en caoutchouc qui, comme des lèvres surgies de nulle part, avalèrent l’œil. Pour un moment, il avait disparu. Et c’est là seulement que Jonathan sentit la fulguration de la frayeur, là que ses cheveux se hérissèrent d’une horreur panique.
Assurément, la présence de ce pigeon et de son regard inquiétant vont perturber le fragile équilibre du quotidien de Jonathan.
Pour tout savoir, il vous reste à lire ou relire « Le Pigeon »…
Benoit



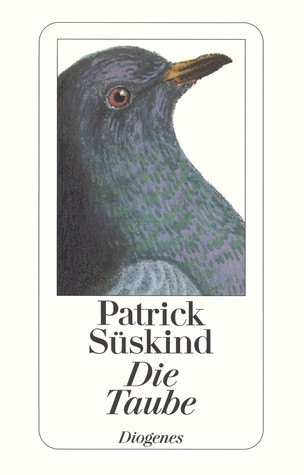





Bonjour Benoit,
Ah, non! Je regimbe, mais enfin pas de lecture à haute voix…avec roucoulement en fond sonore ! Vraiment je vais avoir une journée en mode bouderie…! Mais pas rancunière oui, je vais lire « Le pigeon » ou du moins plus tard : en ce moment suis en littérature vagabonde de Garcin!
Avec taquinerie…merci tout de même !