Portrait de Marcel Proust
PROLOGUE
Depuis environ 7 mois, j’ai passé plus de 150 heures avec la lecture à voix haute de Proust par les comédiens de la Comédie Française ; cela a commencé le 10 novembre 2020. Nous en sommes ce soir 10 juillet 2021 à la 142 ème séquence. Ce fut pour moi une plongée absolument délicieuse dans le monde et dans l’écriture de Marcel Proust. Je n’ai pas toujours goûté avec autant de plaisir les prestations de l’un ou l’autre de ces comédiens, et comédiennes soit que je les trouvais trop rapides, soit que le passage lui-même me parût un peu ennuyeux. Mais c’est un voyage qui m’a apporté vraiment beaucoup de plaisir. Je les écoutais plus que je ne les regardais, le plus souvent en suivant le texte dans mon édition. Parfois je prolongeais la lecture en m’avançant de quelques pages dans le volume ou alors je revenais en arrière pour le goûter en lecture silencieuse.
Je sais que cette lecture prendra fin dans peu de temps et je me prépare à cette séparation. Déjà j’ai trouvé des prolongements à cette traversée proustienne en lisant la récente édition des « 75 feuillets » restés introuvables pendant des décennies et toutes sortes d’articles concernant Marcel Proust.
Pour célébrer donc aujourd’hui 10 juillet 2021, le cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Marcel, je vous propose une lecture d’un inédit, non pas de Proust mais d’un anglais, Stephen Hudson, lequel a écrit le premier texte connu sur la dernière gouvernante de Marcel, Céleste Albaret ; texte inédit encore en Français jusqu’à la parution dans le cahier de L’Herne, en février 2021.
En espérant que cette évocation vous donnera l’envie d’entrer (ou de vous retrouver) dans l’univers proustien…
Anne B.
Stephen Hudson Céleste
(inédit en français) L’Herne « Proust » Cahier n°134 dirigé par Jean-Yves Tadié, février 2021
Traduction de Georges Lafourcade.
Le premier texte écrit sur Céleste Albaret, une nouvelle de Stephen Hudson qui date de 1925, jusqu’ici inédite en France.
Stephen Hudson est le pseudonyme de Sydney Schiff, ami de Marcel Proust,. Il commença à publier ses premiers ouvrages avant la guerre. Il dirigea la revue Art and Letters à Londres et répandit l’œuvre de Proust en Angleterre, en ayant traduit lui-même Le Temps Retrouvé
L’auteur fait parler Céleste (1891-1984), dernière servante de Proust dès l’année 1914, elle a alors 23 ans. Elle resta auprès de lui jusqu’à sa mort en 1922 et rédigea sous sa dictée de nombreux passages de « A la Recherche du Temps Perdu ».
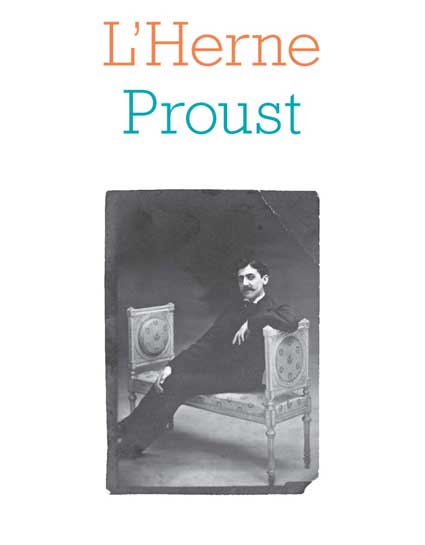
Stephen Hudson "Céleste" (1)
Partie I
Sa façon de voir Marcel Proust écrivant
Ses sens n’étaient point comme ceux de tout le monde. Étendu dans une pièce aux persiennes closes et aux rideaux tirés, dont les murs étaient tapissés de liège pour empêcher les bruits de vous parvenir, il semblait cependant savoir tout ce qui se passait au dehors. Maintes fois, il avait su que quelqu’un était venu et qui c’était, quoiqu’il fût impossible qu’il ait entendu un son, comme aussi il savait ce que l’on allait dire avant que l’on eût parlé. (…)
Il écrivait en tout temps et à toute heure. Il n’y avait pas de régularité. Parfois le jour, parfois la nuit, parfois quelques minutes seulement, parfois des heures durant. Il écrivait dans de larges cahiers de l’espèce usitée dans les lycées, et de ces cahiers il en avait toujours cinq ou six sous la main en même temps. Mais ils ne suffisaient pas toujours et, afin de ne pas interrompre la continuité de ses pensées en me sonnant, il prenait n’importe quel fragment de papier pour servir à ses fins.
Ces fragments, il les mettait parfois à l’intérieur d’un de ses cahiers, mais il les jetait fréquemment sur le parquet à côté de son lit, où ils gisaient comme des flocons de neige pour être rassemblés lorsqu’à la fin j’entrerais. Et malheur à moi si un seul d’entre eux s’égarait, car sa mémoire extraordinaire se rappelait tout ce qu’il avait écrit, sinon la suite exacte des mots. Le morceau manquant devait être trouvé, et cela impliquait parfois une heure de recherches. Ces chiffons de papier, qui m’étaient au moins aussi précieux qu’à lui, étaient pourtant en quelques occasions une source de torture, car de même que celui qui a la seule charge de quelque trésor unique et sans prix chérit sa responsabilité et ne voudrait l’abandonner à personne au monde, mais souffre pourtant les affres de la crainte à la pensée d’un malheur qui surviendrait, de même ces chiffons de papier dont j’étais gardienne me semblaient toujours à la merci d’un souffle fortuit de l’air ou d’une des allumettes enflammées que mon maître jetait ici, là, n’importe où, lorsque durant une de ses crises d’asthme il allumait ses cigarettes spéciales. (…)
Lettres de Céleste Albaret
Stephen Hudson "Céleste" (2)
Partie II
Extrait 2 comment Céleste fut engagée au service de Marcel et ce qu’il pense de ses amis
Céleste raconte à Mme Myrte, amie de Marcel, ses débuts auprès de lui.
Depuis des jours, et même des semaines, comme je le lui disais, il paraissait épuisé et pourtant, le soir dernier, il avait semblé presque lui-même. (…) je lui dis tout. [Je lui dis ]comme treize ans auparavant lorsque, nouvellement mariée à Odilon, j’allais aider Léonie, dont le mari avait été choisi comme gérant de l’hôtel, (…). J’évoquais chaque heure si pleine pour moi, depuis le premier moment où, étendu sur son lit dans la chambre sombre, trop las pour se dévêtir, je l’avais vu devant moi, j’avais vu la belle et pâle figure nimbée de chevelure noire ondulée que j’avais tant admirée de loin parmi la foule qui encombrait la plage, (…) ! Aurais-je pu faire autrement que d’accepter le don qu’avait offert une généreuse providence ? Je sais seulement que, lorsque d’une voix faible il me demandait de fermer un peu mieux les rideaux, d’apporter un autre coussin et un verre de cognac, mon cœur allait à lui et j’aurais fait tout ce qu’il m’aurait demandé.
L’heureux hasard qui me fit répondre à la cloche, dont une femme de chambre affairée et maussade avait négligé l’appel continu, m’avait donné la charge de ce soin précieux. Ces semaines hâtives de bonheur et de souffrance, bonheur du service constant que je fournissais, souffrance puisée dans la conscience de leur fin imminente, me revenaient comme étalées à mes pieds par les vagues dont le flux et le reflux formaient leur accompagnement éternel.(…)
Et quand je lui dis comment, dans un geste d’apaisement, mon maître bien aimé avait touché ma figure de ses doigts et avec une soudaineté qui me fit perdre la parole s’était écrié : « Mais venez à Paris, votre mari sera mon chauffeur, vous tiendrez mon ménage et vous occuperez de moi ».(…)
A propos de ses amis, récents, les Kurt, il lui disait :
Il disait qu’ils étaient ses meilleurs amis maintenant, parce qu’ils étaient les plus récents. (…) Ils le connaissaient comme il était maintenant, non comme il avait été.(…)
— Je ne dois les voir que lorsque je me sens tout à fait bien, Céleste. Richard ne se rend pas compte que l’état de ma santé est très grave. Tant mieux – je préfère qu’il croie que je suis un malade imaginaire.
Il est vrai qu’il se plaignait constamment de sa faiblesse, et personne ne savait mieux que moi combien fragile, combien délicate était sa constitution. Les crises d’asthme, accompagnées d’épuisement nerveux, me causaient une inquiétude constante, (…) quelque chose que je sentais sous ses paroles me causait de l’angoisse. Je devais être sur mes gardes (…)
Le mot « fin »
— Céleste, rappelez-vous ceci : (…) Je sais l’état où je suis. J’ai mon travail à finir. Jusqu’à ce qu’il soit fini, vous n’avez rien à craindre, car je vivrai pour le faire. Après cela…
Il me fit signe de me pencher, et quand ma tête fut assez basse il m’embrassa comme un oiseau derrière l’oreille : — Après cela, nous verrons. Peut-être irons-nous en Angleterre.
À cette époque, ses pensées se tournaient fréquemment vers l’Angleterre à cause de la traduction anglaise de ses œuvres au sujet de laquelle il avait des craintes. Mais quand M. Kurt lui écrivit qu’il était stupéfié de l’excellence de la traduction, qui s’était plus approchée d’une capture complète de l’esprit de l’original qu’il n’avait cru possible, mon maître devint étonnamment mieux et alla même une fois dîner au Ritz. Et cependant il ne faisait que travailler, travailler, corriger, modifier, ajouter. J’étais toujours à ses côtés, lui passant les cahiers, épinglant et collant et découpant.
Puis, soudain, un après-midi : « Regardez, Céleste », dit-il, brandissant le cahier vert :
FIN
Cet unique mot ressortait, solitaire, dans un espace vide, comme l’étoile du soir lorsque le soleil s’est couché et qu’il n’y a pas d’autres étoiles au ciel. Sa figure était radieuse, ses yeux sombres et profonds me souriaient et je souris en réponse. (…)
Stephen Hudson "Céleste" (3)
Céleste Albaret dans la chambre de Proust
Partie III
La fin de Marcel
Quelques jours après, il sentit qu’il avait de la fièvre et il se fit donner le thermomètre, qui confirma ses craintes. Il me dit exactement ce que je devais faire. J’exécutai ses ordres à la lettre. Mais la fièvre augmenta, sa respiration devint de plus en plus embarrassée, puis une attaque d’asthme le priva du peu de forces qui lui restait.
À la fin, en dernière extrémité, il me permit de dire à son frère d’amener un docteur. Je savais alors qu’il n’y avait rien à faire et qu’il savait qu’il était mourant.
Mais son âme demeurait invincible, suspendue au-dessus, au-delà de son corps ruiné et dévasté, l’observant d’en haut, le regardant mourir.
Pourtant il salua le docteur d’un sourire dans lequel moi, qui savais chacun de ses gestes, qui pouvais interpréter chaque nuance d’expression de ses yeux, je savais qu’il y avait de l’ironie lorsque le grand spécialiste sortit son stéthoscope, frappa la douce peau blanche, saisit le poignet.
Je savais les mots mêmes que cette langue sous laquelle le médecin glissait adroitement le thermomètre aurait prononcés, le doux mépris qu’il aurait exprimé pour le mirage d’un espoir qu’il savait être aussi futile que la perte des précieux moments pendant lesquels le flot de la vie se retirait de lui. Enfin, le spécialiste partit après m’avoir ordonné à voix basse de débarrasser la chambre, d’enlever les livres et les papiers, d’écarter les rideaux et de laisser pénétrer l’air ; et Dieu sait quoi. (…)
Ces messieurs sortirent de la chambre et je tombai à genoux à côté du lit. Alors lentement, mais avec un mouvement délibéré de son corps, il parvint à tourner son visage vers moi, dégagea lentement son bras des couvertures que le docteur avait remontées jusqu’à son menton, et posa sa main adorée, sa blanche main délicate, sur mon bras :
— Ecrivez — vite.
Le murmure sortit comme un sifflement très bas à travers ses dents et fut suivi d’une toux grasse qui était affreuse à entendre. Je sentais la pression obstinée de ses doigts et je saisis le premier cahier que je vis.
C’était le vert, celui où il avait écrit « Fin ».
Je retombai à genoux, plaçant le cahier sur le lit, l’encrier sur le plancher et tenant la plume prête pour écrire. Un mot, un spasme, deux mots, trois. J’écrivais, sans penser au sens, absorbée par la seule et urgente nécessité de conserver chacune des gouttes d’or comme elle coulait. Une ligne se forma sous mes yeux, une autre, puis une autre.
Par miracle, il ne toussait pas. Les mots venaient rapidement entre les spasmes. Une demi-page fut remplie, une page. Je la tournai soigneusement, la tenant d’une main de façon à ce qu’elle ne tachât pas, tandis que j’écrivais de l’autre.
La page blanche était un désert à travers lequel nous devions passer sous le soleil calcinant, pas d’ombre, pas d’eau, mais il fallait le traverser, il fallait le traverser. En avant, en avant, en avant. Si seulement je peux porter mon enfant quelques mètres plus loin, rien que quelques mètres – je m’affaisse dans le sable, je tombe, je tombe, j’en suis couverte, je tiens mon enfant contre moi, tout contre moi, jusqu’à la fin.
À quoi pensé-je ? Qu’ai-je rêvé ? Quel est ce son ? Mes yeux se tournent vers le lit, le cahier tombe à terre.
Le son a cessé. Qu’était-ce ? À genoux je me rapproche, j’écoute le bruit de sa respiration. Il n’y en a pas. Il n’y en aura jamais plus.
J’enfouis ma tête dans les couvertures, mes lèvres contre sa main. Je ne sus pas que le frère de mon maître était entré jusqu’à ce que je sentisse quelqu’un debout à mes côtés. Alors lui aussi s’agenouilla et baisa la main cireuse.
Il me pria de lui dire ses derniers moments. Je ne pouvais parler ; je lui tendis le cahier vert.
Il lut les mots et, s’effondrant sur une chaise, il enfouit sa figure dans ses mains.
« Avec son dernier souffle. »
Les mots montèrent, par saccades, d’entre ses doigts crispés.
Marsyas, Le Cailar, avril 1925

Bureau de Proust




Bonjour,
Magnifique et voix si profonde, si expressive! Oui, le mot FIN a aussi sa poésie ! Dans « Les roses de la solitude » de J. De. Romilly le mot « rideau » m’avait tout autant émue !
Merci!