En préfiguration de notre nouvelle lecture scénique « La marche, une aventure humaine », voici des extraits plus larges du livre de Robert-Louis Stevenson « Voyage avec un âne dans les Cévennes ».

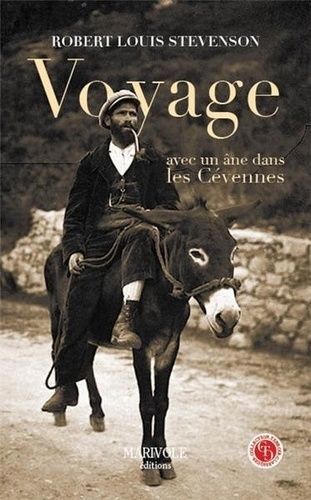
1ère édition anglaise 1879
1ère édition française 1925
Robert-Louis Stevenson, écrivain écossais, est surtout connu dans le monde entier pour deux de ses romans, « L’Île au trésor » (1883), « L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde » (1886).
Il est aussi connu des marcheurs, en particulier en Lozère, car dans son ouvrage « Voyage avec un âne dans les Cévennes« , Stevenson relate sa randonnée entreprise en automne 1878 : la traversée des Cévennes à pied. Parti du Monastier dans la Haute-Loire et cheminant vers le sud, il traverse toute la Lozère pour atteindre douze jours après Saint-Jean-du-Gard dans le Gard, au terme d’un périple de 120 milles (environ 195 km). Son unique compagnie est l’ânesse prénommée Modestine, avec laquelle, malgré des débuts difficiles, il finit par tisser tout au long du voyage des liens affectifs forts.
Après la mort de Stevenson, le succès du livre et l’engouement pour le voyage qu’il relate se développent rapidement, au point qu’à l’occasion du centenaire du voyage, en 1978, un itinéraire de randonnée a été mis en place, pour permettre aux amateurs de répéter le voyage d’aussi près que possible. Cet itinéraire fut ensuite intégré au réseau des chemins de grande randonnée sous le nom de GR 70, appelé le « chemin de Stevenson ».
(d’après Wikipedia)
« Je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L’important est de bouger, d’éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. »
Ce qu’était cette allure, aucune phrase ne serait capable de la décrire. C’était quelque chose de beaucoup plus lent qu’une marche, lorsque la marche est plus lente qu’une promenade. Elle me retenait chaque pied en suspens pendant un temps incroyablement long. En cinq minutes, elle épuisait le courage et provoquait une irritation dans tous les muscles de la jambe. Et pourtant, il me fallait me garder tout à proximité de l’âne et mesurer mon avance exactement sur la sienne. Si, en effet, je ralentissais de quelques mètres à l’arrière ou si je la devançais de quelques mètres, Modestine s’arrêtait aussitôt et se mettait à brouter. L’idée que ce manège pouvait durer ainsi jusqu’à Alais me brisait quasiment le cœur. De tous les voyages imaginables, celui-ci promettait d’être fastidieux. Je m’efforçais de me répéter qu’il faisait une journée délicieuse. Je m’efforçais d’exorciser, en fumant, mes fâcheux présages. Mais la vision me restait sans cesse présente de longues, longues routes au sommet des monts ou au creux des vallées, où deux êtres se mouvaient d’une façon infinitésimale, pied à pied, un mètre à la minute et, comme les fantômes ensorcelés d’un cauchemar, sans se rapprocher jamais du terme. […]
Si je voulais atteindre le bord du lac avant l’obscurité, elle devait mettre ses jambes grêles à vive cadence. Déjà le soleil avait sombré dans un brouillard précurseur du vent et, quoiqu’il demeurât quelques traînées d’or au loin vers l’est, sur les monts et les obscurs bois de sapins, l’atmosphère entière était grise et froide autour de notre sente à l’horizon. Une multitude de chemins de traverse campagnards conduisaient ici et là parmi les champs. C’était un labyrinthe sans la moindre issue. Je pouvais apercevoir ma destination en levant la tête ou plutôt le pic qui dominait mon but. Quant à choisir, comme je m’en flattai, les routes finissaient toujours par s’éloigner de ce but, par sinuer en arrière vers la vallée ou par ramper au nord à la base des montagnes. Le jour déclinant, la couleur se dégradant, la région rocailleuse, sans intimité et nue que je traversais, me jetèrent dans une sorte de découragement. Je vous prie de le croire, le gourdin ne demeurait point inactif. J’estime que chaque pas convenable que faisait Modestine doit m’avoir coûté au moins deux coups bien appliqués. On n’entendait d’autre bruit dans les alentours que celui de ma bastonnade infatigable.
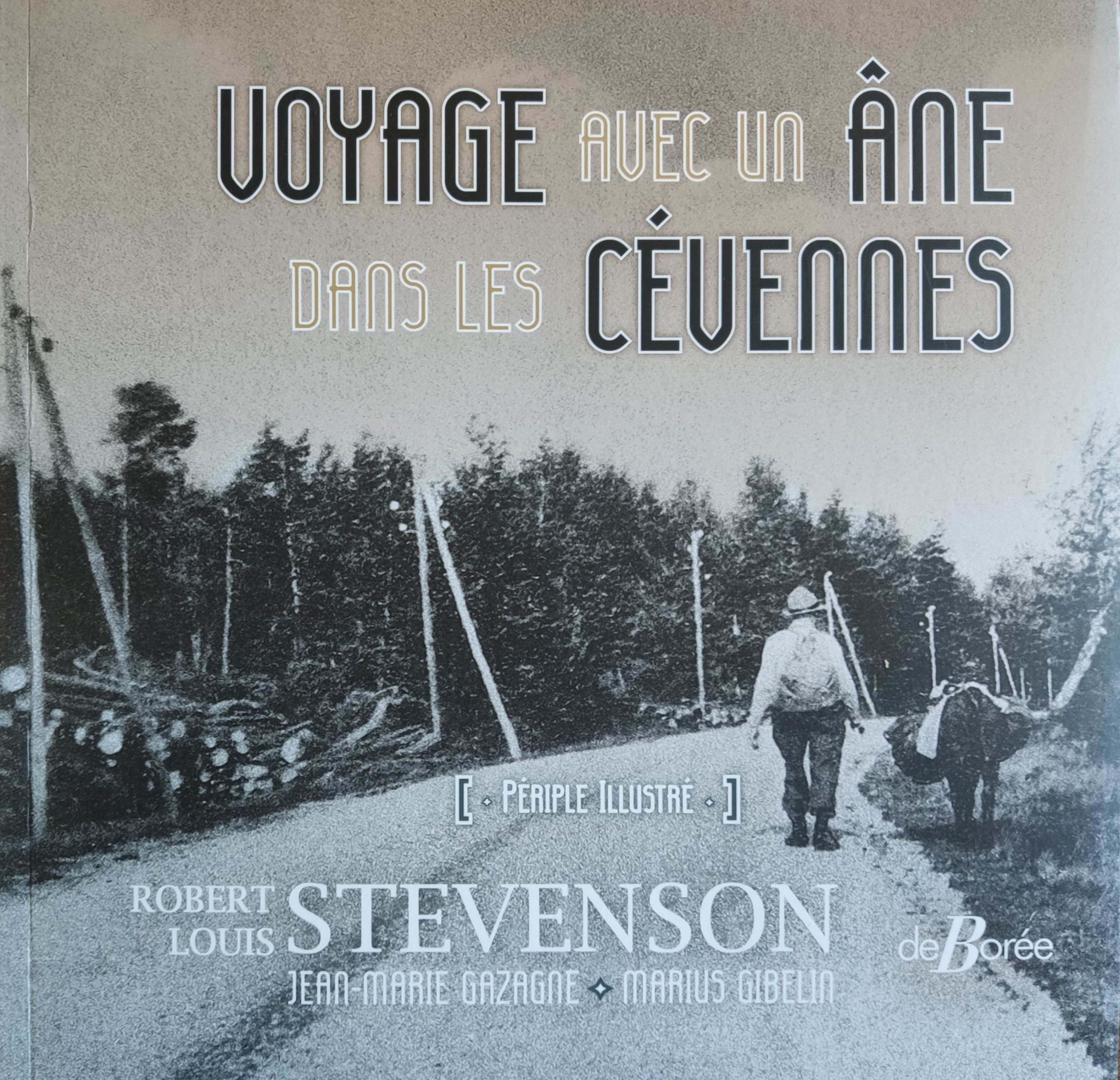
Tandis que je louvoyais désespérément à travers la tourbière, enfants et bétail avaient commencé à s’égailler, si bien qu’il ne restait plus qu’un couple de fillettes en arrière. D’elles je tentai de connaître la direction de ma route Le paysan, en général, est peu disposé à renseigner un chemineau. Un vieux diable se retira tout bonnement dans sa demeure dont il barricada la porte à mon approche et j’eus beau frapper et appeler jusqu’à l’enrouement, il fit celui qui n’entend pas. Un autre m’ayant donné une indication que par la suite je reconnus inexacte, me regarda complaisamment m’engager dans la mauvaise direction, sans esquisser un geste. Il se souciait comme d’une guigne, si j’errais, la nuit entière, par les montagnes. Quant à ces deux jeunes filles, c’était une paire de péronnelles effrontées et sournoises, qui ne pensaient qu’à mal. L’une tira la langue devant moi, l’autre me dit de suivre les vaches et toutes deux se mirent à rire tout bas et à se pousser du coude. La Bête du Gévaudan a dévoré environ une centaine d’enfants de ce canton. Elle commençait à me devenir sympathique. […]
Mes pensées commençaient à s’aiguiller vers le dîner et un coin du feu et mon cœur se calmait agréablement dans ma poitrine. Et j’étais, hélas ! à deux doigts de nouvelles et plus grandes misères. Brusquement, d’un seul coup, la nuit survint. Je m’étais trouvé, à l’étranger, dans maintes nuits obscures, mais jamais dans une nuit plus obscure. Une lueur de roche, une lueur de sentier aux endroits où il était bien frayé, une vague densité floconneuse ou nuit dans la nuit, produite par un arbre – voilà tout ce que je pouvais discerner. Le ciel au-dessus de ma tête n’était que ténèbres, même les nuages continuaient leur course, invisibles à l’œil humain. Je ne pouvais distinguer ma main, à longueur de bras, du chemin, ni mon aiguillon, à même distance, des prairies ou du ciel. […]
Je me secouai, enfilai une fois de plus mes chaussures et mes guêtres puis, rompant ce qui restait de pain pour Modestine, je fis un tour d’horizon, afin de savoir dans quelle partie de l’univers je venais de m’éveiller. Ulysse, échoué en Ithaque et l’esprit en proie à la déesse, ne s’était point plus agréablement fourvoyé. J’avais cherché une aventure durant ma vie entière, une simple aventure sans passion, telle qu’il en arrive tous les jours et à d’héroïques voyageurs et me trouver ainsi, un beau matin, par hasard, à la corne d’un bois du Gévaudan, ignorant du nord comme du sud, aussi étranger à ce qui m’entourait que le premier homme sur la terre, continent perdu – c’était trouver réalisée une part de mes rêves quotidiens.
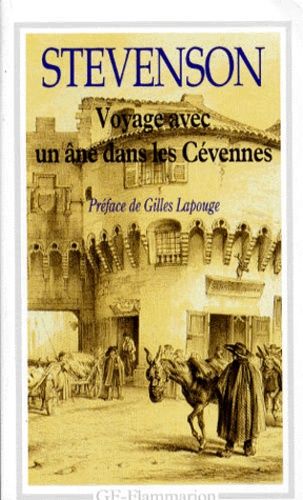
« Personne ne connaît les étoiles qui n’a dormi, selon l’heureuse expression française, à la belle étoile. Il peut bien savoir tous leurs noms et distances et leurs grandeurs et demeurer pourtant dans l’ignorance de ce qui seul importe à l’humanité, leur bénéfique et sereine influence sur les âmes. Les étoiles sont la plus grande source de poésie et, à juste titre d’ailleurs, car elles sont elles-mêmes les plus classiques des poètes. Ces mondes même lointains, brillants comme des flambeaux ou agglomérés comme une poussière de diamants, là-haut, ont été les mêmes pour Roland ou pour Cavalier, lorsque pour emprunter une expression de ce dernier, « ils n’avaient d’autre tente que les cieux et d’autre lit que la terre maternelle » ».
La nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit ; en plein air, par contre, elle s’écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. Les heures y sont marquées par les changements sur le visage de la nature. Ce qui ressemble à une mort momentanée aux gens qu’étouffent murs et rideaux n’est qu’un sommeil sans pesanteur et vivant pour qui dort en plein champ. La nuit entière il peut entendre la nature respirer à souffles profonds et libres. Même, lorsqu’elle se repose, elle remue et sourit et il y a une heure émouvante ignorée par ceux qui habitent les maisons : lorsqu’une impression de réveil passe au large sur l’hémisphère endormi et qu’au-dehors tout le reste du monde se lève. C’est alors que le coq chante pour la première fois. Il n’annonce point l’aurore en ce moment, mais comme un guetteur vigilant, il accélère le cours de la nuit. Le bétail s’éveille dans les prés ; les moutons déjeunent dans la rosée au versant des collines et se meuvent parmi les fougères, vers un nouveau pâturage. Et les chemineaux qui se sont couchés avec les poules ouvrent leurs yeux embrumés et contemplent la magnificence de la nuit. Par quelle suggestion informulée, par quel délicat contact de la nature, tous ces dormeurs sont-ils rappelés, vers la même heure, à la vie ? Est-ce que les étoiles versent sur eux une influence ? ou participons-nous d’un frisson de la terre maternelle sous nos corps au repos ? Même les bergers ou les vieilles gens de la campagne qui sont les plus profondément initiés à ces mystères n’essaient pas de conjecturer la signification ou le dessein de cette résurrection nocturne. Vers deux heures du matin, déclarent-ils, les êtres bougent de place. Et ils n’en savent pas plus et ne cherchent pas plus avant. Du moins est-ce un agréable hasard. Nous ne sommes troublés dans notre sommeil, comme le voluptueux Montaigne « qu’afin de le pouvoir mieux savourer et plus à fond ». Nous avons un instant pour lever les yeux vers les étoiles. Et c’est, pour certaines intelligences, une réelle jouissance de penser que nous partageons cette impulsion avec toutes les créatures qui sont dehors dans notre voisinage, que nous nous sommes évadés de l’embastillement de la civilisation et que nous sommes devenus de véritables et braves créatures et des ouailles du troupeau de la nature. […]
Le monde extérieur de qui nous nous défendons dans nos demeures semblait somme toute un endroit délicieusement habitable. Chaque nuit, un lit y était préparé, eût-on dit, pour attendre l’homme dans les champs où Dieu tient maison ouverte. Je songeais que j’avais redécouvert une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et qui se dérobent aux économistes. Du moins, avais-je découvert pour moi une volupté nouvelle. Et pourtant, alors même que je m’exaltais dans ma solitude, je pris conscience d’un manque singulier. Je souhaitais une compagne qui s’allongerait près de moi au clair des étoiles, silencieuse et immobile, mais dont la main ne cesserait de toucher la mienne. Car il existe une camaraderie plus reposante même que la solitude et qui, bien comprise, est la solitude portée à son point de perfection. Et vivre à la belle étoile avec la femme que l’on aime est de toutes les vies la plus totale et la plus libre. […]
Le brouillard bleuâtre s’étendait dans le vallon où j’avais si agréablement dormi. Bientôt, une large bande orange, nuancée d’or, enveloppa le faîte des monts du Vivarais. Une grave joie posséda mon âme devant cette graduelle et aimable venue du jour. J’entendis le ruisselet avec plaisir. Je cherchai autour de moi quelque chose de beau et d’imprévu. Mais les pins sombres immobiles, la clairière déserte, l’ânesse qui broutait restèrent sans métamorphose. Rien n’était changé sinon la lumière et, en vérité, elle épandait tout un flot de vie et de paix animée et me plongeait dans une étrange jubilation.



Bonsoir!
oui, c’est un régal : marcher mais sans en aimer une marche de printemps qui fouette d’air tonifiant les guiboles, surtout pas celle à adopter à un autre pas, je suis une incurable solitaire. Marcher pour aller où je ne le sais jamais! Je marche et dans ma tête en cadence j’écris…et combien j’ai aimé retrouver le mot « égailler » un idée de joyeux dispersement, un désordre pour échapper à tout ou à rien?
Aussi de Frédéric Gros dans » Marcher, une philosophie » : « la marche fait coïncider l’âme, le corps et le monde ».
Tjrs mes grands mercis.
Merci pour cette belle envolée !
J’en profite pour annoncer que le premier texte de notre lecture scénique « La marche, une aventure humaine » est précisément extrait de « Marcher, une philosophie » de Frédéric Gros.
Et merci pour vos encouragements !
Benoit
Bonjour,
Une réjouissante lecture pour qui connait les plaisirs de la marche solitaire et la plénitude qui envahit celui ou celle qui se réveille au chant des oiseaux.
Belle journée à chacun.e !